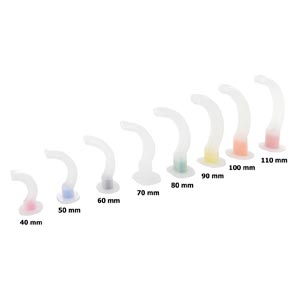L’histoire de l’anesthésie : de l’Antiquité à nos jours
L’anesthésie est sans aucun doute l’une des plus grandes découvertes de la médecine et de l’humanité, un accomplissement qui a radicalement transformé la pratique chirurgicale et amélioré la qualité de vie des patients.
Trouver un moyen d’éliminer ou au moins d’atténuer la douleur lors des interventions a ouvert la voie à de nouvelles possibilités dans le traitement des maladies, permettant des opérations autrefois inimaginables et réduisant les risques qui leur étaient associés.
Les premières tentatives pour soulager la douleur : de la massue à la glace
Depuis l’Antiquité, l’homme a cherché des solutions pour réduire ou éliminer la douleur, notamment lors de procédures comme l’extraction dentaire.
En Mésopotamie, des méthodes drastiques étaient utilisées, comme des coups à la tête ou des compressions sur certaines parties du corps. Les Assyriens, en particulier, pratiquaient l’étranglement en comprimant les carotides pour induire une perte de conscience. Dans ce cas, le risque de dommages cérébraux secondaires était évidemment très élevé. Une technique similaire, qui peut être considérée comme l’une des premières formes d’anesthésie locale, consistait à serrer fortement un membre pour en réduire la sensibilité.
Les Égyptiens furent parmi les premiers à comprendre que le froid inhibait la circulation. Ils collectaient en effet la neige rare des montagnes, la conservant dans des puits spécifiques pour l’utiliser comme alternative à l’eau froide. De plus, ils connaissaient la « pierre de Melfi », une roche riche en silicates qui, selon un ancien traité, lorsqu’elle était frottée sur les parties du corps à couper ou cautériser, parvenait à les engourdir sans causer de dommages.
De la civilisation grecque : la découverte de l’opium et de la mandragore
Déjà dans la civilisation grecque, des solutions herboristiques se sont révélées fondamentales au fil des siècles.
Le médecin Hippocrate, considéré comme le père de la médecine, utilisait des extraits narcotiques comme l’opium (du grec ópion, qui signifie suc) et la mandragore (une plante adoptée plus tard par les Romains). On pense que le terme « anesthésie » a été utilisé pour la première fois dans la Grèce antique.
Le médecin grec Dioscoride, au Ier siècle après J.-C., a inventé le terme « anesthésie » pour décrire les effets narcotiques de la mandragore et a créé la célèbre éponge soporifique, une véritable « bombe » narcotique imprégnée d’opium, de jusquiame, de ciguë, de pavot et de mandragore. L’éponge, séchée puis humidifiée, était placée devant la bouche et le nez du patient pour l’endormir. Cependant, l’efficacité de l’éponge dépendait de la dose : à petites quantités, elle n’avait aucun effet, tandis qu’à doses plus élevées, elle était fatale.
L’effet narcotique de la mandragore a également été confirmé par le Romain Pline l’Ancien. Le naturaliste a raconté qu’il suffisait de sentir la plante avant une opération pour induire le sommeil. Celle-ci s’est rapidement répandue à Pompéi, où ses habitants ont commencé à la cultiver dans leurs jardins.
Au Moyen Âge, bien que la douleur soit principalement combattue avec des breuvages et des potions magiques, l’idée de Dioscoride de l’éponge soporifique est restée la technique la plus utilisée.
De nouvelles substances avec la découverte du Nouveau Monde
La véritable révolution dans la lutte contre la douleur est survenue après la découverte du Nouveau Monde, lorsque les substances provenant d’Amérique ont enrichi la médecine européenne. Parmi elles, on trouve des remèdes utilisés par les populations indigènes, comme le curare et les feuilles de coca.
La connaissance du curare est parvenue aux explorateurs qui ont été en contact avec les populations sud-américaines. En 1595, Walter Raleigh fut parmi les premiers à en documenter l’usage, bien qu’il n’ait pas découvert directement la plante, et il montra qu’il était possible de l’extraire de lianes amazoniennes comme la Strychnos toxifera, en soulignant ses propriétés paralysantes. Le curare était initialement utilisé pour empoisonner les pointes de flèches, tandis que les feuilles de coca servaient à combattre la fatigue et à engourdir la langue et les lèvres.
Entre-temps, à bord des navires au XVIe siècle, les marins avaient recours à une plante du Nouveau Monde, la nicotine, pour anesthésier la douleur.
Avant une intervention, les médecins à bord introduisaient un gros cigare dans l’anus du patient, espérant que le choc provoqué par la nicotine anesthésie la douleur.
L’utilisation de l’alcool dans les premiers conflits
Lors des guerres du XIXe siècle, faire boire les soldats blessés avant une amputation était la règle. En effet, la pratique la plus courante des Européens était l’usage de l’alcool, qui devint le sédatif préféré des chirurgiens pendant des siècles, bien que son effet soit loin d’être anesthésiant.
Les récits historiques montrent que les médecins de l’époque avaient souvent deux bouteilles pendant les interventions : une destinée au patient et l’autre pour eux-mêmes, afin de supporter les cris de douleur des soldats.
La centralité de la chimie dans le chemin vers l'anesthésie moderne
Avec l'avènement des découvertes chimiques, anatomiques et physiologiques du XIXᵉ siècle, la lutte contre la douleur a connu ses premiers triomphes. En 1805, le chimiste allemand Friedrich Sertürner a découvert la morphine, une substance qui semblait promettre un soulagement plus efficace contre la douleur.
À partir de 1842, le médecin américain Crawford Long a utilisé pour la première fois l'éther pour induire l'inconscience lors des interventions chirurgicales.
Cependant, c'est William Morton qui a obtenu une reconnaissance internationale en 1846, lorsqu'il a démontré publiquement l'efficacité anesthésique de l'éther au Massachusetts General Hospital de Boston. Cette démonstration, réalisée dans la salle opératoire rebaptisée par la suite « salle de l'éther », a été un événement marquant qui s'est déroulé devant un public stupéfait. Le patient, Gilbert Abbott, a été anesthésié avec une sphère de verre contenant une éponge imbibée d'éther, sans présenter de dommages immédiatement visibles. Toutefois, l'éther demeurait un produit dangereux en raison de son inflammabilité.
Parallèlement, l'étude des gaz s'est révélée tout aussi cruciale. En 1847, le dentiste Horace Wells a testé sur lui-même les propriétés anesthésiques du protoxyde d'azote, jusqu'alors connu sous le nom de gaz hilarant. Avec courage, Wells s'est extrait deux dents, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle utilisation de ce composé.
À la même époque, l'obstétricien écossais James Simpson a introduit l'usage du chloroforme, qui s'est avéré particulièrement utile pour soulager les douleurs de l'accouchement. Il a connu une large diffusion après que la reine Victoria l'a utilisé en 1853 pour la naissance de son huitième enfant, légitimant ainsi son usage à l'échelle mondiale.
Malgré les limites initiales de l'éther et du chloroforme, comme leur toxicité et les difficultés liées à une administration contrôlée, ces découvertes ont marqué un pas fondamental vers l'anesthésie moderne. Grâce aux pionniers de ce domaine, la chirurgie est devenue moins traumatisante et plus sûre, permettant des interventions plus complexes et prolongées.
Les anesthésiques intraveineux ont été introduits plus tard, en 1872, avec l'utilisation du chloral hydrate et des premières seringues. Plus de 50 ans après, John Lundy a utilisé pour la première fois le thiopental, un barbiturique à action rapide également connu comme le « sérum de vérité », utilisé lors des interrogatoires criminels en raison de ses effets partiellement désinhibants.
Dans les années 1930, les barbituriques (médicaments liposolubles dérivés de l'acide barbiturique, agissant sur le système nerveux central) ont ouvert la voie à une série de découvertes successives d'agents chimiques qui deviendront les principaux ingrédients des anesthésiques modernes.
L'anesthésie telle que nous la connaissons aujourd'hui
Avec l'entrée dans le XXIᵉ siècle, l'anesthésie est devenue une discipline de plus en plus sophistiquée et précise, permettant également le développement de la chirurgie, jusqu'alors pratiquée uniquement en cas d'extrême nécessité, comme pour sauver des vies.
L'utilisation de dispositifs électroniques avancés a permis d'administrer les anesthésiques de manière personnalisée, en adaptant les doses aux besoins spécifiques de chaque patient. L'introduction de la robotique et de l'intelligence artificielle a transformé davantage le domaine, offrant des outils prédictifs et des systèmes automatisés qui assistent les anesthésistes dans la gestion des cas complexes. De plus, des technologies comme les pompes PCA (Patient-Controlled Analgesia) ont révolutionné la gestion de la douleur post-opératoire, garantissant aux patients une plus grande autonomie et un meilleur confort.
Aujourd'hui, l'anesthésie moderne repose sur une combinaison de différentes substances et techniques, en fonction du type d'intervention chirurgicale, des conditions du patient et des préférences du médecin. Les principaux types d'anesthésie incluent :
- Anesthésie générale ou totale : utilisée pour des interventions complexes ou invasives, elle induit un état d'inconscience profonde. Les gaz anesthésiques les plus courants sont le desflurane, l'isoflurane et le sévoflurane, tandis que parmi les anesthésiques intraveineux, on utilise le propofol, le thiopental sodique et la kétamine.
- Anesthésie locale : anesthésie une partie spécifique du corps sans induire d'inconscience. Les anesthésiques locaux les plus utilisés sont la lidocaïne, la bupivacaïne et la marcaïne.
- Anesthésie régionale : bloque la douleur dans une région spécifique du corps, comme pour l'épidurale ou la rachianesthésie, fréquemment utilisée lors de l'accouchement. Les anesthésiques utilisés incluent la bupivacaïne et la ropivacaïne.
- Sédation consciente : maintient le patient éveillé mais détendu et sans douleur, pour des interventions mineures ou diagnostiques. Les médicaments les plus courants sont le midazolam (benzodiazépines) et le fentanyl (opioïdes), qui induisent une sédation et une analgésie sans compromettre la capacité respiratoire.
D'une approche initialement empirique à une discipline avancée et intégrée, l'anesthésie est devenue l'un des piliers fondamentaux de la médecine moderne. Les innovations des dernières décennies ont non seulement rendu possibles des interventions chirurgicales autrefois inimaginables, mais elles ont également considérablement amélioré la qualité des soins et l'expérience des patients.